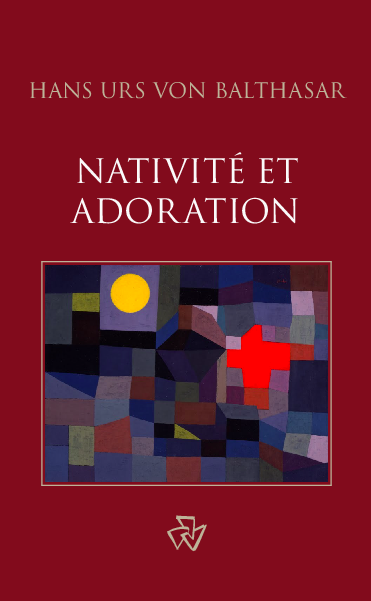menu
Un programme : Communio
Éditorial fondateur du premier numéro de la Communio : Revue Catholique Internationale (édition allemande : 1972)
Du haut de quelle tour de guet notre nouvelle revue veut-elle scruter l’immense cohue que provoque aujourd’hui l’affrontement des diverses visions du monde et lancer quelques signaux de reconnaissance ? La communauté qui se réclame du nom de Jésus-Christ a dû, au cours de sa longue histoire, repenser sans cesse sa situation entre Dieu et le monde. Son être même lui interdit de s’enfermer dans chacun des mots d’ordre qu’elle fait siens, mais qu’elle doit comprendre dans une dynamique toujours ouverte. Pendant les premiers siècles, cette dynamique était tendue jusqu’à la contradiction : les chrétiens se reconnaissaient comme le petit groupe formant, face au monde extérieur hostile et ténébreux, une communauté (koinônia, communio) d’amour réciproque, fondée et nourrie par l’amour de Dieu manifesté et donné en Jésus-Christ. Malgré cela, cette communauté savait, dorénavant qu’elle était « catholique » (déjà chez Ignace d’Antioche, aux Smyrniotes 8,2), c’est-à-dire universelle, et donc normative pour le monde entier. A-t-on jamais vu tension plus forte ! Elle ne pouvait être assumée que dans une conscience « naïve » de foi. Le souffle de l’Esprit Saint pousse alors la barque toujours plus loin (cf. les Actes). Malgré les persécutions, la doctrine se répand d’une manière extraordinaire ; finalement l’empereur lui-même se convertit. Depuis lors, la communauté fondée par le Christ, et le monde, en viennent à se recouvrir, même si la totale pénétration du monde par le levain chrétien reste une tâche toujours proposée, jamais accomplie. Au moyen âge, la tension diminue, parce que l’aire de l’Empire et celle de l’Église sont arrivées à coïncider, formant ensemble la chrétienté. Esprit et structure sont informés l’un par l’autre, et la tension nécessaire entre les deux donne assez l’occasion de tenter des réformes toujours nouvelles pour que le problème bien plus important des relations entre l’Empire chrétien et le monde païen qui s’agite à ses frontières menace de disparaître de la conscience. D’où les gauchissements bien connus qui apparaissent quand on va vers les Temps Modernes. D’abord la funeste association entre l’impérialisme et la mission, puis un certain accent mis par la Contre-Réforme sur la structure hiérarchique et institutionnelle de la communauté chrétienne, à une époque où l’unité médiévale de l’Empire et de l’Église est définitivement brisée. Mais les communautés protestantes, reprenant à leur compte en le durcissant encore le dualisme du christianisme primitif entre l’Église et le Monde, et le transformant en une séparation statique entre élus (prédestinés) et réprouvés (cf. aussi le dualisme de la loi qui tue et de l’esprit qui vivifie), ne feront pas mieux, comme le montre leur pratique de la mission. Le vêtement, cousu trop serré, craquait. La conscience d’être « catholique », c’est- à-dire « universel », poussait sans cesse les meilleurs esprits à tenter le dialogue avec tout ce qui semblait séparé d’eux, pour surmonter la contradiction entre la « catholicité » et le « catholicisme » comme dénomination particulière (« romaine »). Avec le siècle des Lumières et l’idéalisme, l’idée protestante et janséniste de la double prédestination fut dépassée. Les protestants eurent alors le souci inverse de justifier l’existence de communautés constituées, mais à partir d’une conception abstraite et générale du royaume de Dieu.
Ce n’est pas en tirant le fait chrétien d’un côté ou de l’autre qu’on le fera sortir aujourd’hui de sa tension constitutive. S’il ne peut plus prétendre être universel (catholique), il tombe, lui et toutes ses prétentions, fondées sur des textes bibliques ou élevées par une hiérarchie ecclésiastique, au fumier des déchets religieux. Mais si le fait chrétien veut prétendre à l’universalité, il doit être quelque chose de particulier et de bien défini, d’unique face à la pensée de chacun. Pas simplement un phénomène singulier parmi d’autres, mais le singulier par excellence, qui pour cela même peut être universel. Cette fois, nous arrivons à un stade de la réflexion qui n’esquive plus la tension initiale, mais doit la surmonter sans l’atténuer. Nous prenons conscience de ce stade en le nommant : communio.
Il faut ici un mot ancien, qui tient une place centrale dans le Nouveau Testament, dans la large ouverture et dans la force unifiante de sa signification : une communauté formée par l’Esprit de Dieu dans le Christ, qui vécut et ressuscita des morts pour tous les hommes. Dans les différentes formules du Credo, l’expression sanctorum communio, communion des saints, même si elle n’est jamais très accentuée ni bien prise en conscience, suit toujours la formule « Je crois l’Église catholique1 ». Le temps est venu d’en mettre en lumière les implications, car nous trouvons en elle la clef pour expliquer le monde actuel et l’heure de l’Église d’aujourd’hui. Pris dans toute la largeur de ses sens, le mot est un programme, que cette revue se propose de développer. Esquissons-le en quelques lignes.
1. Le Principe
COMMUNIO signifie communauté, au sens concret et précis : être rassemblés dans les mêmes murailles, mais aussi pour une tâche commune, qui peut être en même temps réciprocité dans la complaisance, la grâce, le don. Ceux qui se trouvent en communio ne passent pas de leur propre initiative dans le cercle fermé d’une communauté aux dimensions fixes. Bien au contraire, ils s’y trouvent déjà insérés et sont par avance renvoyés les uns aux autres, pas seulement pour exister tant bien que mal dans un même espace, mais pour mener à bien une tâche commune. Le fait de vivre en communauté nous invite à travailler en commun, – sans exclure le libre choix par chacun de ses modes d’action. Le fait d’être « physiquement » ensemble pose en même temps un problème qui n’a de solution que morale, spirituelle, libre. La simple coexistence acquiert ainsi sa forme humaine : la communauté. Sinon, « les autres, c’est l’enfer ».
Cependant, le fait de former une communauté, la liberté d’en construire une, de la mener à bonne fin et si possible à la perfection, ne se réalise que si l’on se met en chemin de manière consciente et réfléchie vers un but commun : on se rassemble, on prend contact, on engage un dialogue. À ce stade très libre de concertation, il peut y avoir et il y aura dans la discussion des mouvements contradictoires : les avis se confrontent et par là-même s’affrontent et finissent par s’exclure. La phase de la discussion est la phase « critique ». Mot lourd de conséquences : krisis veut dire séparation (donc lutte et choix), mais aussi décision, tournure prise par les événements, et, pour arriver à une décision, recherche, enquête, procès, et finalement jugement. Tout cela est nécessaire à la découverte de la vérité. Déjà chez l’individu, la vérité doit « distinguer pour unir » ; à plus forte raison dans la communauté, où plusieurs libertés et différents points de vue doivent se frayer un passage vers une décision commune et juste.
À présent, tout va dépendre de la solidité du fondement premier, sur lequel reposent tous les processus secondaires de rassemblement et de critique. Demandons simplement : que faut-il supposer pour qu’une communication naisse entre des individus libres et raisonnables ? Suffit-il de vivre côte à côte dans la commune prison de la planète ? C’est le résultat de notre provenance génétique les uns des autres, laquelle remet en question l’image de l’individu comme « atome » indépendant. Faut-il en outre une « communion » dans la raison et la liberté commune, dans un milieu appelé, faute de mieux, la « nature » humaine ? Mais qu’est-ce que cette nature ?
On sait que les Grecs ont pensé à une telle communion quand la nature commune ne fut plus vécue et conçue comme simple idée, mais comme réalité physique. Tel fut le cas chez les Stoïciens. Ceci présupposerait que cette réalité raisonnable qui nous englobe tous soit conçue comme une chose divine, comme le Logos qui s’individualise en chacun et auquel l’individu peut se référer en le reconnaissant comme norme absolue. Un tel principe pourrait imprégner l’ensemble des esprits humains, les ouvrir les uns aux autres et leur permettre de communier dans la vérité théorique et pratique. Le commun et le particulier sont tous deux originels et spirituels. La liberté et la raison personnelles ne trouvent leurs racines ni dans un inconscient collectif, car les individus ne pourraient pas alors communier dans leurs différences essentielles, ni dans une « nature » qui leur donnerait simplement les possibilités et le matériau nécessaires pour décider de leur destin personnel, à l’intérieur duquel chacun resterait solitaire. Ce qui est grandiose dans l’idée antique de la communion entre tous les hommes, c’est que l’on peut participer à la fois concrètement et en commun à ce qui est spécifiquement humain, au logos comme raison « libre ». Cela n’est possible que si les individus participent à un principe divin « librement » raisonnable, toujours présent par avance, dont la « liberté » (comme supériorité sur les contraintes) se trouve en accord avec la « liberté » humaine (comme possibilité de suivre la loi du logos ou de la Nature totale).
Mais une telle conception du monde, qui ne distingue pas entre Dieu et l’homme, est aujourd’hui, après la Bible, irrémédiablement dépassée. Une raison absolue, dans laquelle communient tous les hommes, n’est encore pensable que de deux façons : ou bien, dans le christianisme, comme raison divine transcendante au monde et qui, dans une liberté véritable, nous permettrait de participer à elle par grâce (et c’est par égard à cette transcendance seulement qu’on pourrait l’appeler divine). Ou bien alors comme le but utopique d’une évolution du monde qui, s’élevant à partir de la matière, pousse les individus à se surpasser « vers l’avant », vers la réciprocité d’une communion sans limites dans la raison et la liberté totales. On pourrait, on devrait tout planifier dans cette direction, au besoin en supprimant par la violence révolutionnaire toute réalité privée qui freine. Cet idéal, apparemment si proche, presqu’à portée de la main, il faut le saisir par tous les moyens et le faire entrer de force dans le réel.
Pour les chrétiens, au contraire, la communion que Dieu établit dans l’humanité par le Christ est fondée de deux manières :
En Dieu même, qui ne pourrait offrir une communion personnelle avec lui et entre les hommes s’il n’était pas déjà en lui-même communauté insondable : complaisance des personnes l’une dans l’autre, échange réciproque, qui suppose le respect de la liberté de l’autre par charité. Partout où la Trinité en Dieu (qui seule peut Le faire apparaître comme Amour absolu concret) n’est plus prise en vue, l’idée d’une communauté humaine parfaite ne peut arriver à son plein essor.
D’autre part en l’humanité elle-même : si l’homme n’était pas créé à l’image de Dieu et pour Lui, il n’éprouverait pas en lui cette passion qui le pousse à rechercher une communion toujours plus parfaite entre les hommes, telle qu’il peut la projeter dans le cadre des relations terrestres. Contact, dialogue, communauté des biens, ne sont évidemment que des moyens de l’approcher. La chose même reste finalement transcendante, inimaginable.
Il ne reste plus que cette alternative : ou bien la communion chrétienne dans le principe réel du logos divin qui nous a été donné en Jésus-Christ, comme terme et cime des promesses anciennes, comme possibilité d’une communion totale. Ou bien le communisme évolutif qui, inspiré du pathos juif de l’espoir vers l’avant, tend à la communion totale comme résultat parfait d’un monde et d’une humanité se réalisant eux-mêmes. On le voit : ce n’est que dans le premier cas que la communion est un principe réellement donné et présent. Dans le deuxième, le communisme reste, malgré tous les efforts pour y parvenir, un idéal, et les moyens pour arracher sa venue ne correspondent pas à la spontanéité requise par l’ « humanisme positif ». Les Actes des apôtres décrivent le communisme spontané des premiers chrétiens : « la multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais tout était (considéré comme) commun » (4,32). Ce verset trouva un écho profond dans la théologie des Pères et jusque dans la scolastique. Les fondations successives d’ordres religieux sont toujours comme une actualisation de la communion réelle et réaliste vécue par les premiers chrétiens. Mais ce verset exprime essentiellement un état d’esprit. Car s’il s’agit bien de propriété personnelle qui n’est considérée ni utilisée par personne comme privée, il se peut que saint Luc, afin de mettre en évidence la présence agissante de l’Esprit Saint, décrive en l’idéalisant cet état d’esprit comme sur le point d’être réalisé. Il ne manque cependant pas d’ajouter une restriction, avec l’histoire d’Ananie et de Saphire (5,1-11). L’histoire de l’Église montre avec fracas le gouffre béant qui sépare le principe réel de communion, accordé par avance aux chrétiens – le Corps et le Sang du Christ, donnés par Dieu comme la grâce de la véritable communauté avec Lui et comme principe d’une vie communautaire totale avec autrui dans un seul Esprit Saint, – et la pénible incapacité des chrétiens à vivre en conformité avec ce « Corps » et cet « Esprit ». C’est dans cet abîme que l’entreprise du communisme trouve son lieu théologique, bien que les moyens avec lesquels il tente de réaliser la communion ne puissent jamais correspondre avec ce lieu d’origine. Pourquoi ? Parce que la communion fondée d’avance par Dieu repose sur son abaissement gracieux, son humilité, son dénuement, sur l’effusion amoureuse de toute la substance de Jésus-Christ, tandis que la communion qu’il faut construire de main d’homme ne pourra jamais s’imposer (si elle le peut) sans recours à la contrainte. L’intention du communisme a sa place dans la mission universelle du christianisme, mais ses moyens lui sont opposés, parce qu’ils supposent l’irréalité actuelle du principe de cette communion. Bonhoeffer, en des antithèses tranchées rappelant Luther, a décrit le caractère inconciliable de ces deux projets de communauté, en utilisant les catégories pauliniennes de « pneumatique » (l’Esprit Saint amour donné comme arrhes dans le Christ) et de « psychique » (c’est-à-dire « ce qui vient des instincts, des forces et des dispositions naturelles de l’âme humaine ») : « Dans la communauté spirituelle vit le lumineux amour du service d’autrui, l’agapè. Dans la communauté psychique couve l’amour sombre d’un instinct tout à la fois pieux et impie, celui de l’éros. Là se trouve l’humble soumission au frère ; ici la soumission à la fois humble et orgueilleuse du frère à son propre désir. Là, toute puissance, tout honneur et tout pouvoir sont remis à l’Esprit Saint ; ici, les zones de pouvoir et d’influence de caractère personnel sont recherchées et cultivées. Là règne un amour naïf des frères, prépsychologique, préméthodique ; ici règnent l’analyse et la construction psychologiques. Là le service humble et innocent d’autrui ; ici la manipulation calculatrice et scrutatrice de l’autre2 ». Nous pouvons ajouter, en catholiques, que sans retirer la moindre force à l’opposition de ces deux états d’esprit, on peut assumer maint élément « méthodique » et « psychologique » dans le service de la communion chrétienne. Mais face à l’utilisation nécessaire des moyens humains, un nouveau problème se pose.
Chrétiens, nous ne pouvons pas chercher à créer cette communion : Dieu nous l’a déjà donnée par avance en Jésus-Christ et par l’Esprit Saint « répandu dans nos cœurs ». Toute volonté d’union suppose une unité préétablie, ne provenant pas de nous-mêmes ni de l’union naturelle des hommes entre eux, mais de Dieu qui nous a établis ses enfants et ses cohéritiers dans son Fils. Nous ne pouvons manipuler l’unité qui nous est donnée. Elle provient de Dieu, se réalise en lui, et nous ne disposons pas de Dieu. Que nous-mêmes restions toujours à Sa disposition, au centre même du don de la communion divine, nous l’expérimentons toujours à nouveau dans Son jugement (krisis). Quel homme est ouvert à l’amour de Dieu et par là au véritable amour du prochain ? Peut-être le soupçonnons-nous jusqu’à un certain point, mais ensuite les critères nous échappent. Dieu seul jugera en dernier. Et c’est parce que nous ne devons pas juger, mais laisser le jugement à Dieu qu’il est tant question de jugement dans le Nouveau Testament. Dieu, qui nous fait don de sa propre communauté et de la communion entre nous (1 Jn 1,3-6), s’entend à distinguer (krinein) qui est prêt à recevoir son don et qui ne l’est pas. Mieux vaudrait éviter quelque temps le mot « critique » au lieu de l’adjoindre à tant de substantifs. Il n’appartient qu’à Dieu. Et lorsqu’il demande à des hommes de distinguer avec lui, qu’ils se souviennent que c’est Lui, Dieu, qui est prêt par avance à offrir communion et qu’Il nous la donne réellement. S’il se réserve le jugement, il ne donne par là aucun aperçu sur les limites (ou l’absence de limites) de sa grâce ; nous ne pouvons pas savoir s’il existe des hommes qui se trouvent à tout jamais hors de sa communion. « Qui es-tu pour juger le serviteur d’autrui ? Qu’il reste debout ou qu’il tombe, cela ne concerne que son maître. D’ailleurs il restera debout, car le Seigneur a la force de le soutenir » (Rm 14,4).
Avec une innocence difficile à excuser, la théologie de l’Église a trop longtemps joué au jugement dernier avec ses théories sur la prédestination au salut ou à la damnation ; elle n’a pas pensé assez à fond le fait que le Dieu qui se réserve ce jugement est le même qui en Jésus-Christ est descendu dans le délaissement de tous les égoïstes, de tous ceux qui veulent s’approprier l’Esprit, de tous ceux qui perdent toute relation avec Lui, dans le gouffre de toute solitude antidivine et antihumaine. C’est pourquoi personne n’a plus le droit de mettre sur le même plan l’exercice d’une nécessaire critique et la communion donnée par Dieu. Dans tout contact avec autrui, même manqué et interrompu, chacun doit présupposer l’existence d’une communion englobant tout événement, antécédente, concomitante, et finalement eschatologique. L’exclusion hors de la communauté visible de l’Église (l’« excommunication ») doit toujours être considérée comme une mesure pédagogique et provisoire servant à aider le coupable (cf. 1 Co 5,5 ; 2 Co 2,6). Et même si nous ne « savons » pas si finalement tous les hommes seront reconduits par la grâce divine à la communion définitive entre Dieu et l’homme, nous avons cependant en tant que chrétiens le droit et le devoir de l’espérer, d’une espérance toute « divine », voulue et donnée par Dieu. Le principe qui fonde et soutient notre pensée pour tous les hommes jusqu’au dernier, notre dialogue avec le plus proche comme avec celui qui l’est moins, est une Parole de communion fondée par Dieu, non seulement promise de loin, non seulement offerte, mais réellement donnée entière à l’humanité entière. C’est dans cette Parole que nous parlons et gardons le silence, que nous nous tournons vers les autres ou nous détournons d’eux, que nous tombons d’accord ou restons en désaccord.
Concluons cette première série de réflexions en constatant que le terme de l’alternative, qui consiste à vouloir créer une communion par nos seules forces, ne pourra jamais aboutir. Lorsque se fut envolé le rêve antique selon lequel le meilleur de chaque individu comme celui de la communauté est divin, il devint impossible de proposer une médiation où tous les hommes puissent communier tout en gardant leurs libertés, et qui, réelle, n’entrerait pas en concurrence avec elles ou, seulement idéale, serait trop faible pour les unir. Il est clair ainsi qu’un inconscient collectif n’est pas la médiation propre à assurer la moindre communauté de destin de personnes libres ; pas davantage un monde hégélien de l’esprit, qui n’inclut en lui les individus qu’au prix de l’abandon en lui de ce qui en fait des fins en soi. À ce prix, les individus peuvent communier entre eux dans les religions orientales aussi : mais l’identité détruit la conscience. D’autre part, ce n’est pas assez cher payé, si cette communion n’est qu’objet d’espérance eschatologique, et non insertion dans notre temps. Car alors, toutes les générations qui cheminaient vers elle sont laissées pour compte, ne servant que de matériau. Elles sont exclues de la grande fête de la communauté.
2. Portée de l’entreprise
La communion universelle (catholique) n’est pas une communion parmi tant d’autres. Elle est la communauté donnée par Dieu, accordée en toute liberté et d’une portée sans limites. Soyons très clairs sur ce point : sa portée dépend du réalisme des présupposés, c’est-à-dire :
de la réalité (certes insondable) du fait que l’essence de Dieu est vie trinitaire, communion absolue, et que Dieu a créé l’homme à son image et l’a appelé à participer à sa nature (2 P 1,3).
du fait que Dieu s’est donné à tous en assumant toute la nature humaine en Jésus-Christ, pour sauver tous les hommes comme il l’avait prévu (1 Tm 2,4), pour prendre sur lui ce qui avait été perdu (1 Co 5,20), se réconcilier le monde entier dans le Christ (2 Co 5,18sq.), abattre dans le crucifié les cloisons qui nous séparaient (Ep 2,12sq.). En lui, le ressuscité, il a voulu briser les frontières de la vanité, de la mort et de la solitude absolue des morts, afin de les accueillir tous dans une vie définitive, éternelle (1 Co 15,22).
du fait qu’au cours de la Cène, Jésus-Christ nous a partagé son corps et a fondé ainsi la communion, non pas magique, mais sacramentelle et objective, de ceux qui participaient au repas, communion par laquelle nous participons à la nature divine de Jésus-Christ et les uns aux autres (1 Co 10,16sq.). En lui nous pouvons faire pour les autres quelque chose qui dépasse nos possibilités humaines, dans la mesure où nous avons part à la souffrance du Christ qui a lui-même souffert pour son Église et en elle pour tous les hommes (Col 1,24) dans une destinée commune avec notre Seigneur. C’est avec lui que nous vivons, souffrons, sommes crucifiés, mourons, sommes ensevelis, que la vie nous est rendue, que nous sommes glorifiés, que nous héritons du Royaume et que nous régnerons. Communauté de destin proposée d’avance à tous les hommes et qui seule justifie la différence entre Église et Monde.
De cet espace sacramentel et objectif doit finalement naître, sans solution de continuité, la communion dans l’Esprit Saint. Fondée par avance en Dieu, la communauté ne supplante pourtant pas la liberté humaine. Au contraire, elle l’admet d’avance en elle. (C’est là la place de la mariologie, et c’est elle qui en dernière analyse repoussera tout soupçon de magie). L’esprit communautaire qui nous est donné n’est ni un « esprit objectif » (Hegel) seul, ni un esprit promis pour la fin des temps, mais l’Esprit absolu pénétrant nos esprits libres (Rm 5,5; 8,8sq. ; 15,26sq. ; Ga 4,6sq.), dont les aspirations deviennent en nous aussi infinies qu’en Dieu. « Tout est à vous » dans la mesure où vous appartenez au Christ, qui, lui, est dans le Père (1 Co 3,21). C’est l’Esprit qui, pour achever l’œuvre du Christ, unit nos esprits « en un seul corps », en les imprégnant tout entiers de lui-même (1 Co 12,13). Il n’agit plus de l’extérieur, mais de l’intérieur, du centre de la liberté humaine (1 Co 2,10-16 ; 7,40 ; Rm 8,26sq.). Cette prétention catholique à l’universalité est sans analogue dans l’histoire des religions parce qu’elle ne supprime aucun élément humain au profit d’un autre, et prend en égale considération l’humain et le supra-humain ; elle permet toutes les audaces, mais ses exigences sont les plus intransigeantes qui soient.
Dans le Christ est posé le fondement de la paix rétablie entre Ciel et Terre, entre le point de vue du Créateur et celui du monde créé. Celui-ci peut bien vivre en soi-même et proclamer abstraitement sa séparation d’avec le Ciel, une absence ou une mort de Dieu. Les puissances et dominations qui le mènent peuvent bien se vivre et se sentir comme agressivité, volonté de puissance, etc., et même hostiles à un Dieu de l’amour seul, des valeurs nobles mais impuissantes (Max Scheler). Une telle opposition peut bien se donner l’allure d’une réalité, voire la posséder dans son domaine (cf. Ap 1). Elle n’en est pas moins dépassée là où, avant toute lutte dans le monde, le mur entre le Dieu du ciel et l’homme terrestre a été abattu (Ep 2,14sq.). En s’abandonnant dans le Christ à la domination des ténèbres et de toutes les puissances destructrices, Dieu créa l’Eucharistie – chair déchirée, sang versé –, la communion entre ce qui semblait s’exclure définitivement. Dans l’Évangile de Jean, c’est juste à Judas que la bouchée est présentée. Dans l’esprit de communion, le chrétien est convaincu que « ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté dans le Christ notre Seigneur » (Rm 8,38). Il est permis de transposer ici les représentations liées à l’image ancienne du monde dans celles du monde moderne : les lois techniques et évolutives, les concentrations de pouvoir et les planifications, les superstructures idéologiques et les sapes de la psychologie des profondeurs, l’arme atomique, la cybernétique, les manipulations des gènes, tout est contenu par avance dans la communion, dans la paix établie, « qui surpasse tout ce qui est pensable » (Ph 4,7).
Venons-en maintenant aux grandes oppositions qui semblent irréductibles à l’intérieur du monde, à moins qu’on n’en minimise superficiellement la portée (ce qui se retourne toujours contre ceux qui le font). Ne parlons pas de la tension entre capitalisme et communisme, où tant de ressorts sont déjà détendus, mais bien de l’opposition entre Juifs et Païens, qui a commandé de façon inavouée mais centrale l’histoire du monde jusqu’à maintenant et la commande plus que jamais (2). Il s’agit bien ici du Sic et non3 suprêmes : les chrétiens disent que la réconciliation fondamentale nous est donnée et qu’il s’agit de se l’assimiler et de la vivre ; elle n’est pas encore là, disent les Juifs, et il faut tendre de toutes ses forces vers elle, comme vers « ce qui vient ». Ce Sic et non passe comme un glaive tranchant à travers tous les évangiles. Il y est vaincu, non pas dans les dialogues, mais dans l’Agneau muet crucifié pour son peuple, et pas seulement pour lui, mais « afin de rassembler dans l’unité tous les enfants de Dieu dispersés (dans le monde) » (Jn 11,52). Pierre, qui l’a renié, remet au Seigneur le pouvoir de juger et se solidarise avec les Juifs : « Je sais, frères, que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs » (Ac 3,17), c’est pourquoi il laisse sa chance à l’espérance immémoriale, éternelle, des Juifs en l’avenir : c’est en commun avec vous, les Juifs, que nous, Chrétiens, attendons l’arrivée (le retour) du Messie (Ac 3,20-26). Paul lui-même, malgré la conversion de la « loi » à l’ « Évangile », du travail de l’homme à l’action comme don, reste « un pharisien issu de pharisiens et est mis en jugement pour notre espérance, la résurrection des morts » (Ac 23,6) ; il sait4 ce que signifie l’élection d’Israël, et que Synagogue et Église doivent réciproquement se céder la place (Rm 11).
Le dialogue peut aider à supporter et à diminuer les tensions entre chrétiens, mais seule la communion y mettra un terme. Il faut citer en premier lieu la tension entre Églises orientale et occidentale, entre lesquelles existe une communio in sacris, communauté des sacrements, signe d’une entente fondamentale. Cette communion est-elle vraiment présente à l’esprit de la théologie occidentale, de type catholique ou protestant, dans les discussions et les projets ? Celle-ci ne s’éloigne-t-elle pas plutôt à une vitesse accélérée de la vénérable Église des origines – sauf chez quelques-uns comme Louis Bouyer ou M.-J. Le Guillou – dans sa manière de comprendre la tradition, la liturgie ou le ministère ecclésial, comme si cette Église primitive était dans le dialogue des nations quantité négligeable, et ce certainement au préjudice de ses contempteurs étourdis ? Ne dialoguons-nous pas même de préférence (peut-être pour des raisons politiques) avec l’Orthodoxie, et ne négligeons-nous pas du coup, comme si elles n’existaient pas, les Églises uniates, alors que les hommes d’Église occidentaux portent la responsabilité de la teinte que Rome leur imposa (dans la mesure où elle est encore réelle) ? Entre chrétiens aussi il y a des génocides.
Le dialogue avec les Protestants et les Anglicans ne peut être engagé positivement qu’à l’intérieur de la communion avec le Christ, avec la certitude cependant que nous n’en disposons pas nous-mêmes, mais devons nous laisser saisir par elle. Celui qui le comprendra de la manière la plus profonde, réaliste, exigeante, aura le plus de chances d’avoir raison dans les conversations, saura le mieux dépasser les arguments superficiels et les points de vue partiaux pour s’élever à une vision plus universelle. Ce n’est pas en bricolant des unions entre Églises que nous nous rencontrerons à cette profondeur, mais en reconnaissant les exigences de la communion, donnée par avance dans le don que Dieu nous fait de lui-même.
Le passage aux non-chretiens et aux adversaires du Christ s’opère graduellement, car le monde est pénétré des effets du christianisme. Encore faut-il s’assurer que les ennemis du Christ ne combattent pas des caricatures qui ne révèlent plus rien de la vérité du fait chrétien, la masquent entièrement peut-être ; ne cherchent-ils pas parfois à récupérer à leur manière des préoccupations essentielles, qui incombaient aux chrétiens et que ceux-ci ont négligées ? À la limite extrême, se trouvent ceux qui restent volontairement à l’extérieur, les « apostats », contre lesquels l’Église primitive nous a si souvent et si expressément mis en garde. Elle le fait provisoirement, car même le cœur du plus dur renégat peut se fondre, l’homme isolé peut commencer à sentir le froid de la mort et chercher secrètement autour de soi une main tendue. Quelqu’un repousserait-il la communion, cela ne signifie pas qu’il puisse lui échapper en dernière instance. S’il abandonne, il n’est pas pour autant abandonné. Le chrétien, lui, pour qui la communion est le signe de ralliement, s’en remet à son Seigneur qui ne nous abandonne pas.
Il faut aussi rester en communion avec tous ceux qui connaissent Dieu, ou le divin, ou l’absolu, et tous ceux qui pensent ne pouvoir admettre ni l’un ni l’autre. Là encore, les frontières restent floues. Pensons au bouddhisme. Deux choses sont exigées du chrétien : qu’il parle avec les adeptes d’autres religions du fait de son propre engagement, et non par mode ou par sentiment de supériorité missionnaire. Il doit entrer en contact avec les Musulmans, auxquels le lient de nombreux faits bibliques, ainsi qu’avec les formes indiennes et extrême-orientales de théologie négative, où aboutissent tous les projets religieux non-chrétiens ; qu’il les aborde avec le même respect et la même compréhension que jadis les Pères de l’Église. Il devra ensuite entrer non seulement en dialogue, mais aussi en communion avec les marxistes. Parce que la communion est déjà là, toujours présente dans le Christ, il devra tenter, dans Sa charité, un dialogue honnête, qui sache distinguer le vrai du faux et aider son partenaire à aller plus loin, sans tour de passe-passe, ni haine ou préjugé. C’est peut-être lui, le chrétien, qu’on abandonnera, lui à qui son Seigneur, qui n’abandonne jamais, n’a pas permis d’abandonner.
Cela signifie encore une fois que la réalité de la communion comme telle n’est à la merci ni de l’homme, ni du chrétien, ni même de l’Église. Elle est un horizon vers lequel se dirige toute expérience chrétienne de Dieu et du prochain, mais elle ne se laisse pas mesurer d’après cette expérience. Il est important de le souligner aujourd’hui, où la communauté chrétienne n’est plus, pour beaucoup, qu’un squelette d’institutions, et où le petit groupe, dans lequel s’éprouve la communauté, devient pour eux de plus en plus le critère unique de la vie ecclésiale. L’Église comme Église catholique, c’est-à-dire universelle, est pour eux comme un toit séparé de leur maison, planant bien au-dessus des étages qu’ils habitent. Dans l’expérience de communion de ces groupes se trouve certainement un grand espoir de régénération par la base, mais tout autant le danger d’une décomposition en sectes charismatiques. Tout l’effort de Paul en dialogue avec les Corinthiens visait à soustraire la communion ecclésiale à l’emprise de l’ « expérience » purement charismatique, et à la faire sortir d’elle-même par le moyen de la fonction apostolique pour l’orienter vers la Catholicité. Cette fonction est, bien sûr, un « service », non une « domination », mais un service avec « pleins pouvoirs » pour abattre toutes les forteresses que les charismatiques élèveraient contre la communion universelle et les amener à « obéir au Christ » (2 Co 10,5). Celui qui nivelle la fonction ecclésiale au niveau charismatique (démocratique) perd ainsi ce qui élève au-dessus d’elle-même, inexorablement et de façon cruciale, toute charge particulière : au niveau de la Catholica, dont l’unité ne réside pas dans l’expérience (gnôsis), mais dans l’amour qui renonce à soi-même (agapè). La première finit par détruire, tandis que l’autre construit (1 Co 8,1).
L’agapè est d’abord don reçu d’en haut. C’est seulement ensuite qu’elle peut approximativement être imitée par nous. C’est pourquoi la communion « horizontale » entre les hommes ne pourra jamais donner la mesure de celle, verticale, qui est fondée sur Dieu. Sinon nous retomberions dans l’idée d’une Église s’engendrant soi-même dans une interprétation pharisaïque de la loi, ou dans la vieille hérésie donatiste (plus dangereuse aujourd’hui que jamais) selon laquelle chaque chrétien ne peut donner que ce qu’il réalise existentiellement.
La communion est l’horizon ultime que nous ne pouvons rejoindre ni par notre expérience ni par nos exploits ; il reste le don éternellement gratuit. C’est pourquoi la prière n’est jamais dépassée et ne s’identifie jamais à l’action : « priez sans cesse » ; explicitement (comme tous les hommes de la Bible, et Jésus aussi) et implicitement dans vos échanges avec les autres, mais aussi dans votre « chambre ». La parole est le privilège de l’homme, parce qu’il est l’image de Dieu qui, dans son essence, est Verbe. Sans la communication libre et consciente dans le Verbe, la communion resterait une entreprise magico-cosmique. Nous devons toujours demander de réaliser ce qui existe à partir de Dieu, le remercier pour tout ce qui nous est donné, et toujours adorer en rendant grâces la réalité de cette communion.
3. L’exigence
Celui qui connaît l’ampleur de la communion est plus sollicité que tout autre. Il n’a pas besoin d’être un brillant penseur qui (par exemple grâce à la dialectique hégélienne) peut adopter chaque point de vue et en le distinguant lui assigner sa place légitime : l’homme qui comprend tout. Mais il doit être celui qui ne cède pas dans une situation que, comme penseur ou même comme homme, il ne comprend plus ou presque plus, lorsque l’horizon ultime où tout est commun ne lui est plus accessible. Ce n’est pas le savoir absolu, mais l’amour absolu qui englobe les adversaires. En lui se trouvent réconciliés malgré tout ceux qui ne se comprennent pas, qui peut-être même ne peuvent plus se souffrir. Dans le corps du crucifié, Dieu a « mis à mort l’inimitié » (Ep 2,16), si bien qu’il n’y a plus à strictement parler, dans un sens chrétien, d’amour des ennemis : l’ennemi prétendu ne sait pas que dans la sphère définitive et seule vraie, son inimitié est dépassée. Certes, un bouddhiste ou un stoïcien pourrait contresigner cette phrase. L’attitude du cœur diffère pourtant. Bouddhistes et stoïciens s’entraînent à pénétrer dans la sphère sans souffrance et sans haine. Les contradictions qui les assaillent ne les atteignent pas, ils communient avec l’ennemi dans un Absolu supra-personnel. Le chrétien en revanche doit ouvrir son cœur et se laisser atteindre, provoquer, blesser jusqu’au plus profond de lui-même. Dans le Christ, Dieu est parvenu jusqu’au pécheur le plus solitaire, pour communier avec lui dans la déréliction divine. La communauté chrétienne est fondée sur l’eucharistie, qui suppose la descente aux enfers, dans mon enfer et dans celui de l’autre. On n’a pas le droit de s’en évader vers une union abstraite. Il faut plutôt le courage d’avancer vers cette forteresse bien armée qu’est l’autre et d’y entrer – non sans le parachute de l’Esprit – jusqu’en son plein milieu, avec la certitude qu’en dernière instance elle est déjà conquise et s’est déjà rendue. Cela peut provoquer l’autre à la résistance la plus âpre : il faut la supporter, ce qui n’est possible que dans la parfaite humilité que donne la foi en l’acte divin de charité, acte qui précède le nôtre et exclut tout triomphalisme, même celui de la charité. Je n’aurai jamais le temps de triompher, car je dois me solidariser avec la situation de l’autre, tout renfermé sur soi, pour lui prouver ainsi que même dans le plus solitaire il y a communauté, que même vers celui qui s’est détourné complètement, quelqu’un peut se tourner. La communion est fondée le Samedi Saint, après le cri de l’abandon, avant que le tombeau n’ait été forcé : dans le mutisme absolu, au-delà de tout dialogue, dans le silence de l’existence avec le Seul. « Seul avec le Seul », avait dit Plotin ; ce mot s’approfondit – verticalement et horizontalement – dans ce fondement ultime d’où surgit tout ce qui est chrétien.
Nous ne dirons pas qu’il faudrait, en chaque discussion, évoquer explicitement ce fondement dernier. Ce serait fort indiscret. Mais il doit toujours être présupposé comme une réalité, parce que c’est en lui que la communauté existe effectivement. Sans quoi tout dialogue reste stérile. On cause, on fait un bout de route ensemble ; puis, quand cela devient difficile et provisoirement désespéré, on se sépare et chacun va son chemin. Seulement, il n’existe pas de double vérité, même dans l’ère du pluralisme. Chrétiennement parlant, il n’en est qu’une seule, qui ne s’est pas manifestée dans la puissance, mais dans l’impuissance de la solidarité avec le dernier des hommes. Tous les arguments introduits dans le dialogue, et qui peuvent être convaincants, convergent en dernière instance vers ce point. Toute la froide théorie de Marx plonge ses racines dernières dans un cœur déchiré par la misère des plus pauvres. C’est par ce cœur que le chrétien doit se laisser provoquer ; et le dialogue peut ensuite clarifier ce qu’il faut aujourd’hui prévoir et entreprendre.
Entreprendre ce qui dans le monde concret est possible n’est pas ruiner les structures, dans l’espoir utopique d’un lendemain tout autre sur cette terre. À cet irréalisme s’oppose la vérité plus grande d’une communion déjà réellement présente. Toujours, dans chaque dialogue, c’est la vérité plus grande qui a raison, et toujours les partenaires doivent se référer à elle. La catholicité, c’est d’admettre cette vérité plus grande, de se laisser mettre en question par elle. Et cette exigence exorbitante est la condition grâce à laquelle nous allons à la rencontre de la communion réelle, et devenons participants de celle qui nous possède déjà. Savons-nous d’ailleurs qui est le plus pauvre ? Les riches ne sont-ils pas plus pauvres que le chameau qui ne peut passer par le chas de l’aiguille ? Que le don de discernement et tout l’art dialectique de penser et de dire se manifestent dans la rivalité des visions du monde ! Augustin n’a pas eu peur devant la philosophie grecque la plus prétentieuse, ni Thomas devant la spéculation raffinée des arabes, ni Nicolas de Cues, Leibniz, Kepler ou Teilhard devant les essais cosmologiques des Temps Modernes. Avec plus ou moins de bonheur, ils indiquent la direction, ils n’esquivent pas l’effort redemandé chaque jour. Mais à quel point, justement parce qu’ils étaient grands, ils connaissaient la communion, et combien elle les dépasse ! Car nous sommes tous embarqués dans le même navire.
Voilà ce que nous tenterons avec Communio. Pas question de parler sans dévoiler toutes ses batteries, en se reposant sur la possession d’un capital de « vérités de foi ». On a déjà dit que la vérité, à laquelle nous croyons, nous dépouille. Comme des agneaux parmi les loups. Il ne s’agit pas de fanfaronnade, mais du courage chrétien de s’exposer. Des hommes entrent en communion quand ils n’ont ni pudeur ni honte à s’exposer les uns devant les autres. C’est alors que cesse d’être un paradoxe vide la phrase : « quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12,10).
- C’est bien « Je crois l’Église » et non pas « Je crois en l’Église » comme le dit le credo français, qui ne suit pas le latin : credo Ecclesiam. [N.D.R.]↩
- Gemeinschaft, 1966, p. 22sq.↩
- Allusion au livre d’Abélard intitulé Sic et non [N.D.R.].↩
- Cf. ma brochure Dans l’engagement de Dieu, Apostolat des Éditions, Paris, 1973.↩
Hans Urs von Balthasar
Titre original
Communio – Ein Programm
Obtenir
Thèmes
Fiche technique
Langue :
Français
Langue d’origine :
AllemandMaison d’édition :
Saint John PublicationsTraducteurs :
Françoise Brague, Rémi BragueAnnée :
2024Genre :
Article
Source
Revue catholique internationale Communio 1/1 (Paris, 1975), 2–16