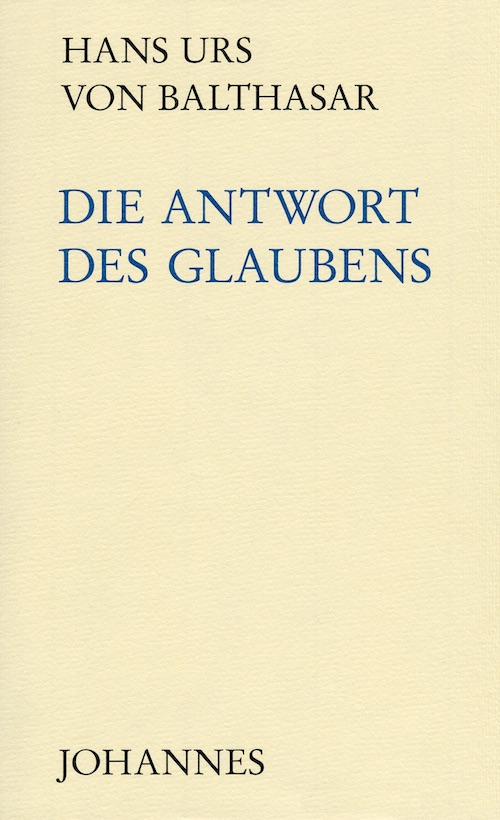menu
Le christianisme et les religions du monde
Un aperçu
L’espace ici offert est trop étroit pour un traitement exhaustif du thème ; il doit être utilisé au moins pour prévenir la bêtise qui consiste à placer les religions dites « du monde » comme des unités se tenant les unes à côté des autres et de même valeur, à partir desquelles on peut s’intéresser à l’une, selon son gré, et s’y vouer. La religion règne là où l’homme sait qu’en définitive il doit se montrer reconnaissant pour son existence. Là où cela ne lui vient pas à l’esprit (par oubli), ou bien là où il pense ne pas pouvoir le faire (à cause du caractère effrayant du monde), il tombe dans la rébellion contre Dieu (ce qui en définitive est un contre-sens, si Dieu, le Bien absolu, existe) ou dans l’athéisme, qui ne permet aucune interprétation du sens de l’existence personnelle et sort du domaine des religions. Nous passerons, en trois pas, du plus général au particulier ; à la fin nous nous interrogerons sur la possibilité d’une convergence des religions, sur leur intégration.
1. Les deux hémisphères
Dans le monde actuel se dessinent nettement deux domaines du religieux : l’hémisphère occidental est marqué par la religion de la révélation : judaïsme, christianisme et islam (qui descend des deux) : ici règne l’idée d’un Dieu libre, personnel, qui sans aucune contrainte a inventé et posé dans l’existence le monde réel : en tant que l’autre de lui-même, qui porte toutefois nécessairement le cachet de son origine, l’« être à l’image de Dieu ». En face de lui, le monde oriental, dans toutes les variantes de sa religiosité1, est dominé par la représentation d’un divin impersonnel, par le fondement originaire qui en tant que tel « apparaît » nécessairement dans la multiplicité en quelque sorte irréelle du monde, mais doit être cherché derrière l’apparition, le phénomène, qui le voile. Si on fait abstraction des religions dites « primitives » et des groupes sans religion, les deux blocs se font face avec environ un milliard2 d’adhérents chacun.
Ce qui les différencie, c’est qu’en Occident une révélation venant de Dieu et entrée dans l’histoire a rencontré l’homme religieux, alors qu’en Orient ceci n’est pas le cas : ici le mouvement va essentiellement de l’homme religieux vers l’absolu-divin (même si un être particulièrement illuminé comme Bouddha ou Lao-Tse trouve et indique la « voie »). Mais ce qui leur est commun, c’est que l’homme se connaît lui-même comme se tenant dans une relation intime à Dieu (à l’absolu) : soit qu’il se comprenne maintenant (occidentalement) en tant que « à l’image » de Dieu, ou (orientalement) en tant que « forme d’apparition » d’abord voilée, aliénée, de l’absolu.
Ce point en commun est d’une importance fondamentale. L’homme dans son individualité isolée se sent de façon élémentaire référé (re-ligio) à un fondement originaire de sa naissance, et la réalisation de cette relation (dans la contemplation intérieure comme dans l’action extérieure) l’établit en premier lieu dans sa « vérité ». Être « image » ou être « apparition » ne sont par conséquent que point de départ d’un mouvement, d’une transcendance. Les Pères de l’Église chrétiens ont exprimé ceci de façon classique en interprétant l’affirmation, au début de la Bible, que l’homme est « créé selon l’image et la (ou : en vue de la) ressemblance de Dieu » (Genèse 1,26), dans le sens que l’« image » est la nature créée de l’homme, image qui doit elle-même – par un effort conscient et par la grâce prévenante de Dieu – se purifier et se parfaire en vue d’une « assimilation » rendant semblable à l’archétype qui est Dieu. Quelque chose d’analogue vaut de toutes les formes orientales de la religion : ici aussi l’homme doit « transcender » son essence naturelle, dans laquelle il se trouve au départ, pour parvenir à sa réalité véritable. Dans les deux hémisphères « l’image » qu’est l’homme vaut comme quelque chose qui doit être travaillée, purifiée, pour que la ressemblance se réalise peu à peu : l’homme veut d’abord être seulement tel qu’il se trouve de prime abord, il est accroché égoïstement à sa forme d’apparition, il ne veut pas se reconnaître redevable et remercier, ou ne le fait que non-volontiers et superficiellement ; il doit se « surmonter », pour parvenir à un amour oublieux de soi, préférentiel, de son archétype divin.
Mais ici jaillit de nouveau, et plus fortement, la différence. En Occident, où Dieu est reconnu comme quelqu’un qui crée librement, le soi de chaque individu est un vis-à-vis voulu, et en tant que tel, aimé, de Dieu ; 1’« oubli de soi » [Selbstlosigkeit] de l’amour signifie donc ici que je dois passer de l’égoïsme de mon moi à un amour désintéressé de Dieu, de mes semblables (qui tous sont une personne unique voulue par Dieu), et de moi-même – non sans le secours de la grâce divine. En Orient par contre, le moi individuel n’est que l’apparition d’un fondement originaire divin (ou « Soi »), « oubli de soi » signifie par conséquent « laisser-derrière-soi » l’individualité apparente propre pour vivre à partir du noyau de vérité dans lequel tous les individus sont identiques. Dans les deux hémisphères il y va d’« oubli de soi », et dans les deux pour cette raison que Dieu, ou l’Absolu, est « oublieux de soi », mais le sens, en correspondance à la représentation qu’on se fait de Dieu, est autre : en Occident, la personne (qui demeure) doit être oublieuse de soi parce que Dieu a créé le monde et moi-même sans aucune nécessité, à partir d’un Amour oublieux de soi ; en Orient l’individu doit renoncer à son être-moi [Ichsein], parce que le divin est dépourvu de moi3. L’amour oublieux de soi occidental (particulièrement l’agapê chrétien) aime Dieu pour lui-même et le semblable parce que sa personne est aimée absolument par Dieu ; l’amour oublieux de soi oriental est avant tout compassion (maitrî) avec l’être encore emprisonné dans les liens de l’être-moi (homme, animal ou plante). Individualité est identique à souffrance, celle-ci ne peut être supprimée efficacement que par détachement de l’être-moi.
Parce que l’absolu, en Orient, n’est en fin de compte pas personnel (il y a certes des divinités personnelles avant-dernières, aucune religion populaire ne pourrait s’en passer), il peut bien y avoir faute (dont la conséquence sur le chemin de la rédemption est rechute dans une nouvelle individuation), mais pas ce que l’Occident appelle péché : atteinte à l’amour personnel et à la sainteté de Dieu, également dans son commandement de l’amour du prochain. D’une faute, l’homme peut s’affranchir lui-même en principe par des actions compensatoires ; mais pas du péché, à moins que le pardon de Dieu n’ait l’initiative, à laquelle l’homme répond par la conversion.
Tout ceci est le cadre théorique qui différencie profondément la religion des deux hémisphères en dépit d’un phénomène fondamental commun – la connaissance d’un nécessaire rapport en arrière (religio) avec le fondement originaire. Mais par là tout n’est pas dit : d’après la compréhension occidentale, surtout chrétienne, Dieu, dans une libre miséricorde, s’est tourné vers tous les hommes ; même ceux qui ne le connaissent pas de par la révélation biblique historique. Nous ne pouvons donc pas savoir si des hommes qui cherchent l’absolu-impersonnel « de toute leur âme » ne rencontrent pas, ce faisant, dans le secret, l’Amour du Dieu libre. Il y a aussi des formes de la religion orientale qui approchent de près la compréhension occidentale de la grâce : par exemple le bouddhisme – Amida, surtout au Japon, et l’école de Râmânuja (XIe siècle), qui à la fin de sa vie pensait ne plus pouvoir parvenir à la rédemption par la simple connaissance, mais découvrait dans l’absolu même des traits de l’amour.
Il y a ainsi, en dépit de singularités notables, des chemins parcourables entre Ouest et Est. L’Orient peut montrer à l’Occident suraffairé la nécessité du calme et du recueillement intérieurs, que celui-ci devrait au fond connaître de lui-même puisqu’elle est la condition pour entendre dans le cœur la parole « silencieuse » que Dieu nous adresse. Mais l’Occident peut montrer à l’Orient ce qu’est – au-delà de toute « compassion » – l’amour personnel de Dieu et du prochain, et ce dont il est capable. Ce qu’aucun Indien n’a fait : ramasser dans les rues de Calcutta ceux qui meurent dans la misère, et leur montrer enfin le sourire de l’Amour de Dieu, Mère Teresa l’a fait. Ce qu’elle fait et ce qu’elle est, c’est précisément cela l’exemple de vie qui doit être donné à l’Orient, s’il doit tenir pour possible l’incarnation définitive de Dieu dans un homme historique (et son imitation). Que Dieu se tourne, descendant jusque dans l’historique-unique, vers l’homme qui le cherche, qui ne peut le trouver de ses propres forces et même avec les techniques les plus élevées, c’est là le plus de l’Ouest, qui nous contraint maintenant à aborder les religions de la révélation.
2. Les trois « religions abrahamiques »
Avant que nous traitions de celles-ci, il faut encore relever la situation précaire dans laquelle se trouvent les religions orientales. Le bouddhisme a pratiquement disparu de sa terre d’origine, l’Inde ; l’hindouisme qui le remplace est entremêlé d’une quantité de superstition polythéiste. Le shintoïsme japonais, comme polythéisme fortement motivé politiquement, est aboli (depuis 1946) en tant que religion d’État, et reste religion privée nationale. Le confucianisme, depuis toujours plus éthique sociale que religion, a été aboli par le maoïsme. Les méthodes de méditation (yoga, bouddhisme zen) puissamment répandues en Europe, ne sont plus représentées, dans les pays d’origine, que tout à fait rarement, dans des cercles intellectuels. La question se pose, si avec la pénétration de la civilisation technique occidentale les polythéismes (« en premier plan ») ne sont pas condamnés à une extinction rapide, tandis que les doctrines (« en arrière plan ») d’un fondement impersonnel du monde se laissent marier facilement avec des variantes de l’athéisme marxiste.
Au contraire, les trois religions monothéistes qui tirent leur origine de la révélation historique, judaïsme, christianisme et islam, montrent une bien plus grande vitalité, et ce dans toutes les couches de population. Mais elles ne représentent en aucun cas trois expressions, se tenant l’une à côté de l’autre et de même valeur, d’une espèce commune. La racine est constituée par le judaïsme qui tire son origine de la première révélation faite à Abraham, plus tard à Moïse, et pour autant que le christianisme et l’islam reconnaissent également cette origine, toutes les trois se laissent caractériser comme « religions abrahamiques ». Des philosophes de la religion (L. Massignon) et des papes (particulièrement Paul VI) ont cherché à promouvoir l’entente des trois sur la base de cette origine. Mais une telle entente n’est pas facile, bien que pour toutes les trois le monothéisme personnel soit la base à tenir ferme en toutes circonstances.
Le judaïsme reste à travers tous les temps ce qu’il était dès le début : la religion du peuple élu, en quoi réside, dans cette nationalité [Volkstum] qui s’est maintenue de manière non-équivoque en dépit de son nombre peu important et de son mélange avec tous les peuples du monde, quelque chose d’énigmatique, presque pas explicable naturellement, qui continue à unir les juifs entre eux, même là où l’orthodoxie juive et même la direction conservatrice ont été abandonnées. Le nouvel État d’Israël, dans lequel les juifs croyants forment une minorité, en est la meilleure preuve. Cela n’empêche cependant pas que l’attachement à la foi des pères, à la loi mosaïque et son interprétation prophétique, constitue le noyau, toujours agissant de manière vivante et se régénérant, de la religiosité juive.
Le christianisme est fondé sur la reconnaissance de Jésus de Nazareth comme le messie promis au peuple juif – qui n’a pas été reconnu par les juifs et est dans le meilleur des cas considéré par certains comme un prophète –, et en outre comme le Fils faisant partie essentiellement de Dieu qu’il a appelé son Père dans une signification unique, qui, après sa mort en croix et sa résurrection, a transmis l’« Esprit Saint » divin. Ici, le monothéisme (strictement maintenu) montre donc une richesse intérieure (un Dieu en trois « hypostases » est en lui-même, par essence, Amour), que judaïsme et islam considèrent comme faisant sauter l’idée du monothéisme. Le refus des juifs de reconnaître Jésus comme leur messie apporte par ailleurs pour les chrétiens une fracture dans l’histoire du salut des hommes, qui ne peut être guérie par des conventions œcuméniques seules, mais ne peut être résolue qu’à la fin des temps. Le christianisme reconnaît l’Ancien Testament juif comme la nécessaire et durablement significative préhistoire de l’alliance définitive avec Dieu en Jésus-Christ (dans cette mesure il est « religion abrahamique »), tandis que le judaïsme conteste la légitimité de l’accomplissement néotestamentaire.
L’islam est dépendant, dans son écriture sainte le Coran, aussi bien de l’Ancien que du Nouveau Testament. Abraham, Moïse et Jésus sont en lui les précurseurs prophétiques de la révélation prophétique définitive faite à Mahomet. Mais juifs et chrétiens auraient en partie oublié, en partie faussé la révélation originaire, que le dernier prophète présenterait dans sa pureté. L’unicité absolue de Dieu (d’Allah) et l’abandon confiant à sa volonté (islâm, ceux qui en vivent sont muslim) est l’unique contenu théologique, entouré toutefois par une foule de devoirs rituels (prière requise cinq fois par jour, pèlerinage, jeûne, aumônes imposées) et de prescriptions légales. Des influences d’autres religions orientales ont aussi afflué collatéralement. Mais le monothéisme radical fait apparaître l’islam comme un judaïsme ou judéo-christianisme (hérétique) (d’où sont sorties des influences démontrables sur Mohammed), qui aurait été dépouillé de sa dynamique eschatologique (du Messie à venir ou du retour du Christ) ; à la place de quoi s’est installée en lui périodiquement une poussée d’expansion politique confessante.
Judaïsme et islam forment ensemble avec leur monothéisme rigide un front contre le christianisme, qui apparemment met celui-ci en danger par le dogme de la Trinité. Les deux se recommandent par la simplicité de leur position de fond à tous ceux qui voudraient croire en un Dieu personnel et s’abandonner à lui, les deux en tirent la prétention de pouvoir devenir la religion (de l’humanité). Mais les deux restent attachés à des moments qui contestent cette prétention universelle. Dans le judaïsme, l’élément national [völkisch] (on peut certes devenir prosélyte, mais pas vraiment juif) ; dans l’islam, le ritualisme, qui même pour les Arabes n’est exécutable intégralement qu’avec fatigue, et pour des étrangers n’est presque pas exécutable du tout. En outre, la conscience juive de l’élection érige entre Israël et son entourage sémitique – comme cela devient visible aujourd’hui – des barrières apparemment infranchissables : peut-être d’une espèce plus encore religieuse que politique.
Le point de départ des deux est le clair se-tenir-face-à-face de Dieu et de la créature, précisément aussi dans la révélation de Dieu et dans son « alliance ». Les deux ne peuvent cependant pas résister à la nostalgie religieuse originaire de l’homme, d’une union avec Dieu. Ainsi certains courants secondaires ont poussé dans les deux à l’accueil de moments des religions (« orientales ») de la nostalgie : une mystique juive et une mystique musulmane se sont ainsi formées (cabalisme-hassidisme, Sûfîs). Dans le christianisme, ce moment de l’union n’a pas besoin d’être introduit de l’extérieur ; il est déjà donné centralement en Jésus-Christ, qui est Dieu et homme, et dans ses sacrements et son imitation. C’est pourquoi le christianisme n’a besoin également d’aucun complément oriental : le « mystique » en lui est sa dogmatique vécue de manière conséquente.
Pour les trois « religions abrahamiques », quelque chose de décisif est encore à ajouter. Elles ont toutes un noyau de membres fidèles et zélés, et un cercle plus large de suiveurs qui se sentent ou disent en faire partie sans se soumettre à toutes les obligations. Mais de nouveau, cette « baisse de niveau » est, dans les trois religions, d’une nature très différente. Dans le judaïsme, où l’élément national [volkhaft] forme pour lui seul déjà un lien, l’athéisme même est à la limite possible. Et chez ceux qui croient en Dieu, l’échelonnement est grand entre ceux, relativement peu nombreux, qui suivent tout le rituel (dans la mesure où après la destruction du Temple et la suppression des sacrifices, etc. il peut encore être suivi) et ceux qui font leur choix ou ne se soucient pas des rites. Chez les musulmans, où à part la confession pour Allah les autres « colonnes de l’islam » sont toutes de nature rituelle mais ne sont plus que peu ou pas du tout praticables pour beaucoup qui se trouvent dans la vie technicisée moderne, règne, dans une mesure croissante, une « situation de détresse » – ce qui ne doit pas mettre en doute la force de foi toujours encore étonnante de cette religion.
Face aux deux le christianisme présente un avantage évident. Tout en reconnaissant pleinement l’Ancien Testament il a – à l’exemple de Jésus – distingué dans la loi de Moïse ce qui demeure de ce qui est dépassé. D’autre part (et cela est encore plus important) il n’y a plus dans la religion de Jésus de distance entre le dogme (un Dieu, qui est devenu homme en son Fils et nous a donné son Esprit) et le rite : ce ne sont pas le jeûne et le pèlerinage (comme dans l’islam) qui sont le rite central, mais la « mémoire », instituée par Jésus lui-même, de sa mort et de sa résurrection « pour nous et pour la multitude », l’Eucharistie ; tout autre advenir (rituel) sacramentel se groupe organiquement autour de ce centre. Et en celui-ci, s’il est vécu dans une foi vivante, jaillit aussi, comme on a dit, immédiatement, ce qu’on peut appeler l’élément « mystique » dans le christianisme.
Parce que le christianisme, en son centre, demande à croire un fait aussi inouï que l’incarnation rédemptrice de Dieu, et pose à partir de là à ses fidèles, en correspondance, de hautes exigences éthiques, la « baisse de niveau » entre le noyau des chrétiens authentiques et le cercle des suiveurs est particulièrement grand, et, pour son image à travers l’histoire, particulièrement pénible. Pourtant l’Église est nécessairement les deux : Église-levain et « Église populaire » qui est portée-avec par la première. Elle doit essayer de compenser les scandales que donnent ses membres imparfaits et indignes, par une imitation du Christ plus conséquente ; elle doit essayer de laisser luire le noyau à travers l’écorce. Mais elle ne pourra jamais être une simple « Église des purs ». Les mêmes attentes ne sont pas posées par le monde à l’égard du judaïsme et de l’islam comme à l’égard de l’Église, car elle est seule à proclamer la filiation divine de Jésus-Christ et l’exigence de son imitation, non seulement dans la vie privée, mais en rendant témoignage devant le monde entier et jusque dans les problèmes éthiques et politiques du monde : droits de l’homme, justice sociale, cessation des guerres et des tyrannies. Car à partir du mystère de Jésus et de son comportement, pour la première fois, toute la dignité de la personne individuelle, et par là également de son cadre social, s’est mise à briller. Des équipées missionnaires guerrières (la conquête de l’Amérique Latine, par exemple) sont chrétiennement une contradiction en soi. Au contraire, une figure comme celle de Charles de Foucauld peut avoir valeur de modèle : présence d’un chrétien sans défense en territoire musulman, vivant en même temps dans le service des pauvres et dans l’adoration de l’Eucharistie.
3. Les christianismes
Que les commencements des religions orientales, provenant de l’homme religieux, et ceux, occidentaux, dérivant de l’initiative de Dieu, ne sont pas à réunir en une synthèse générale, cela est clair ; mais il est tout aussi clair que les religions abrahamiques sont incompatibles entre elles : le judaïsme ne peut admettre que Jésus soit le Messie, et en même temps demeurer lui-même ; le Coran ne peut pas reprendre l’affirmation que ni l’Ancienne ni la Nouvelle Alliance ne sont la révélation non-falsifiée, mais seulement la dictée de l’ange Gabriel à Mahomet.
Il en est autrement des différentes « religions » chrétiennes : celles-ci procèdent d’une racine unique. Elles savent également que la division contredit l’essence de [l’élément] chrétien, et que la réunification, aussi dure qu’elle puisse être, est un devoir inconditionnel, mais qu’elle ne peut advenir par l’abandon de quelque chose d’essentiel quant à son origine, à la volonté du Christ. Un pluralisme d’Églises contredit clairement son intention fondamentale, de faire connaître au monde la vérité de son message de Dieu par l’unité aimante de ses disciples.
On ne peut évoquer ici que très brièvement les deux schismes dans l’histoire de l’Église du Christ (à partir desquels surtout ont éclaté les innombrables sectes) : la séparation de l’Église orientale et de l’Église occidentale puis la naissance de nouvelles Églises à l’époque de la Réforme.
La première grande séparation est bien plus le résultat d’un devenir-étranger [Entfremdung] culturel et politique, que d’une désunion dogmatique ; par la suite seulement, les différences dogmatiques furent artificiellement exagérées. Aux maladresses diplomatiques vient s’ajouter une clarification insuffisante du rôle du pape comme successeur de Pierre et de sa primauté : à l’intérieur de la collégialité des Douze il a à « paître » le « troupeau » tout entier ; la fonction, donc, de garder l’unité de la vérité dans l’amour : une fonction délicate qui, du côté des collègues dans le ministère (évêques, patriarches), comme de l’évêque de Rome, ne pouvait être résolue que dans l’esprit de l’amour du Christ. L’excommunication réciproque prononcée par les Églises orientales et occidentales est actuellement levée. Des différences doctrinales séparant les Églises ne subsistent pas. Aussi peut-on se demander avec raison si l’on doit parler ici sérieusement de deux Églises, ou plutôt d’un devenir-étranger partiel à l’intérieur d’une communion ininterrompue. D’autant plus que des deux côtés la transmission des ministères, jamais interrompue depuis l’origine, a régné jusqu’à aujourd’hui.
Ce n’est pas aussi simple pour ce qui concerne les Églises nées de la Réforme, de l’éruption desquelles l’Église catholique (occidentale) était co-responsable par de lourdes fautes. Ici en effet les différences doctrinales, d’une part, sont beaucoup plus profondes (quand bien même les réformateurs avaient l’intention, avec leurs doctrines, de rétablir les origines), d’autre part régnait la volonté d’interrompre la tradition catholique des ministères et de comprendre le ministère délibérément autrement : non pas comme un plein pouvoir transmis par le Christ et les apôtres, mais comme un plein pouvoir appartenant à la communauté et conférable par elle (et par conséquent limité). (La différence est au plus net dans la suppression du plein pouvoir sacramentel catholique de la rémission des péchés dans la confession). Ici aussi les différences doctrinales furent exagérées plus que nécessaire : l’avis, qui semblait jadis séparer les Églises, concernant « la justification à partir de la foi seule » ou par une coopération de l’homme (« œuvres »), est à considérer aujourd’hui comme une querelle réglée. Ainsi, le point de discorde capital reste l’origine du plein pouvoir ministériel. Mais la décision à ce sujet dépend de nouveau de l’évaluation de la tradition vivante.
Le ministère catholique est ce qui rend possible le fait de rendre présent de façon vivante le Christ « tous les jours jusqu’à la fin du monde » dans son Église marchant à travers l’histoire. Que manque ce ministère, alors la liaison en retour de l’Église à l’Écriture Sainte devient nécessaire comme l’unique garantie essentielle de cette présence. Et même si le Nouveau Testament ne contient pas en soi – comme l’Ancien et comme le Coran – des choses vieillies, il n’est pas cependant, en tant que tel, la Parole vivante de Dieu (que le Christ est seul), mais uniquement son témoignage authentique, qui doit être complété – si l’interprétation ne doit pas échoir à l’arbitraire du croyant individuel ou des exégètes – par la compréhension ecclésiale de la Parole de Dieu, compréhension gardée par le ministère et transmise à travers les temps. Le même ministère institué par le Christ garantit également le fait de rendre présent toujours à nouveau le Christ cheminant avec nous, dans le sacrement de l’Eucharistie4. Quand l’Écriture est déclarée seule garantie de la vérité, alors, si son interprétation pneumatique vivante est permise à chacun de la même manière, elle se retrouve déchirée par les compréhensions divergentes et perd son caractère normatif.
Mais une période déterminée de l’histoire de l’Église – par exemple l’époque avant le schisme entre l’Orient et l’Occident – ne peut pas non plus être déclarée normative pour tous les temps, sinon c’en est fait une fois de plus de la présence vivante du Christ marchant à la rencontre de l’avenir, et l’Église devrait, pour prendre ses décisions d’aujourd’hui, s’orienter uniquement à la « période classique » de ses premiers siècles. Avoir reconnu cela (contre les objections orthodoxes ainsi que les anglicanes) par un approfondissement de la tradition vivante de l’Église, et avoir trouvé le chemin qui mène de l’Église des Pères (où s’arrête l’Orthodoxie), et de l’Église de l’Écriture (où demeurent les Églises issues de la Réforme), à l’unité catholique vivante, en ayant tout mis à l’abri et emporté des stades franchis, est le mérite de la troisième figure qui doit être nommée en ces pages : celle de John Henry Newman.
4. Vers une religion de l’humanité ?
Les voix se multiplient qui, en correspondance à la culture mondiale unique qui est en train de se former, appellent une religion mondiale unique, dans laquelle les oppositions relatives des grandes religions du monde ici décrites pourraient et devraient être surmontées. Au fond cela est déjà l’idéal de l’Aufklärung du XVIIIe siècle (qu’on pense au « Nathan le Sage » de Lessing et à son « Éducation du genre humain »), mais dont les précurseurs remontent jusqu’à l’humanisme de la Renaissance, même jusqu’au projet d’un « troisième règne de l’Esprit » (abbé Joachim de Flore au XIIe siècle) après le « règne du Père » (Ancienne Alliance) et le « règne du Fils » (Nouvelle Alliance, Église chrétienne).
À cette vision de rêve s’opposent pourtant, comme nous l’avons déjà vu en partie, les prétentions réelles des religions du monde à une ultime validité, voire « absoluité ». Les religions de l’Orient déploient une intuition fondamentale excessivement simple, pour ainsi dire schématique-abstraite : celle de l’unité de tout l’être, qui n’est recouvert que secondairement par les arêtes apparemment dures de l’individuation, mais qui se découvre de lui-même et se révèle à quiconque s’enfonce dans les profondeurs des racines de l’être. « Tat twam âsi – C’est toi », dit alors à l’illuminé tout être de prime abord étranger. Cette expérience, qui est la plus simple, est l’absolu, au-delà de toutes les révélations historiques (des religions abrahamiques) et relativisant celles-ci sans peine. Mais les religions occidentales affirment connaître un Dieu bien plus vivant, se révélant personnellement, qui se démontre, seulement à travers cette sienne auto-révélation, comme le véritable absolu, tandis que tout étant mondain existe en venant de lui et en allant vers lui. Le judaïsme élève pour lui la prétention d’absoluité, parce qu’il se tient dans l’origine toujours maintenue de cette révélation. Le christianisme élève la même prétention parce que cette révélation obtient sa plénitude indépassable seulement en Jésus-Christ. L’islam l’élève pour lui parce qu’il est la dernière et définitive religion du monde5. Ces prétentions ne s’aboliront en aucune synthèse supérieure, d’autant que, comme cela fut montré, certains éléments du judaïsme et de l’islam s’opposent à la généralisation tandis que de son côté la prétention d’absoluité des religions orientales exige la relativisation de toute révélation historique (qui en tant qu’« avatars » sont simplement à chaque fois de nouvelles « apparitions » du divin mais jamais une véritable incarnation), ce que les religions occidentales, si elles comprennent leur essence originaire, ne peuvent jamais consentir.
Le rêve d’une religion de l’humanité pourrait demeurer irréalisable à l’intérieur de l’histoire du monde. Mais le spectacle de ces figures de la religion agissant l’une à côté de l’autre sur la scène du monde doit-il continuer inchangé, éternellement ? Un mouvement est concevable dans trois directions :
1. Nous vivons une énorme avancée de la (soi-disant) totale perte de la religion [Religionslosigkeit], de l’athéisme, forcé politiquement dans les pays communistes, se répandant épidémiquement dans le monde occidental sur-saturé de culture et de religion. Eu égard à cette pression venant des deux côtés, les religions du monde peuvent-elles résister encore longtemps ? On peut dire là contre que la question religieuse ne peut pas s’éteindre en l’homme (en tant qu’il est une « image » de l’absolu, qui veut connaître l’« archétype » et s’assimiler à lui). Le caractère indéracinable de la religion, précisément là où elle est persécutée le plus violemment et de la façon la plus intolérante, le montre. Et le fait (occidental) de ne plus poser la question de Dieu est un phénomène d’affaiblissement qui réfute sa propre validité. Le sens religieux dans la nature de l’homme peut être endormi, mais jamais extirpé. Parce que les grandes religions le possèdent toutes et le maintiennent vivant, parce que toutes scrutent le fondement divin du sens de l’existence, elles possèdent un profond caractère commun [Gemeinsamkeit], donc entre elles doit régner par principe la tolérance.
2. Il s’est avéré en outre (au moins dans les grandes lignes) qu’une religion peut élever la prétention de mettre à l’abri en elle tout le positif des autres et de les accomplir néanmoins en les dépassant : celle qui depuis toujours s’est appelée la religion « englobante » (c’est ce que signifie l’expression « la religion catholique »). Et ceci bien que ses adhérents et suiveurs n’aient que trop souvent manqué, à travers leur longue histoire, de fournir l’exemple de cette catholicité. La prétention d’universalité repose sur la figure de Jésus-Christ, qui est d’une sorte unique, sans analogie, dans l’histoire du monde, qui accomplit toutes les prétentions des religions orientales, du judaïsme et de l’islam, mais en élevant pour lui-même la prétention d’une autorité et d’une transmission de vie divines. C’est pour cette prétention qu’il fut crucifié. Il accomplit et dépasse la prétention du judaïsme d’avoir l’alliance avec Dieu : parce qu’il est lui-même, en tant que Dieu et homme, cette alliance, et ce à travers une révélation de l’Amour divin qui se livre, spontanément et de manière substitutive, pour tous les péchés des hommes les rendant étrangers à Dieu, et qui les réconcilie avec Dieu dans sa « chair sacrifiée » et son « sang versé » : « Il est notre paix ». Face à cette exubérance l’islam signifie un net pas en arrière, car (s’il est orthodoxe) il en reste au pur vis-à-vis de Dieu et de l’homme : dans une attitude d’adoration digne d’admiration et toutefois en fin de compte inaccomplie. Mais on voit également que dans l’unité humano-divine de Jésus, et dans l’unité des hommes avec Dieu qui est médiatisée par Jésus, la nostalgie orientale de l’être-un s’accomplit sans que l’homme n’ait besoin de se perdre en tant que personne. Ce qui à l’Orient apparaît comme la quadrature du cercle6, devient effectivement résolu en Jésus-Christ. La célèbre formule du Concile de Chalcédoine (451) l’exprime très schématiquement : le Christ a la vraie essence divine et la vraie essence humaine et il n’est pourtant qu’un unique « Qui » : il révèle dans sa vie humaine toute la profondeur de l’essence de Dieu (« Dieu est l’Amour »), mais également toute la dignité de l’homme : comme « enfant de Dieu » « avoir part à la nature divine ». Pour l’Orient, pour le juif et le musulman, ce sont là des paradoxes, qui apparaissent comme des contradictions selon la logique humaine. Pour le chrétien ces paradoxes sont lisibles simplement à la figure de Jésus, comme il se donne et se dit lui-même dans les évangiles. Et cela de façon tellement évidente qu’aucun artifice exégétique ne peut en avoir raison.
3. L’attente chrétienne de l’avenir pourrait donc voir juste, quand elle voit l’histoire du monde empirer jusqu’à l’ultime confrontation du Christ et de l’Antichrist, du christianisme et de l’athéisme. Il est d’une importance fondamentale de voir qu’il n’y a d’athéisme authentique que post-chrétien : en tant qu’anti-théisme. Avant il y avait la possibilité d’être en même temps religieux et « athéiste » : par exemple dans le bouddhisme. Le fondement du monde était alors un mystère profondément caché, qui se trouvait encore au-delà de toutes les images concevables de Dieu. Cela est même valable pour des « athéismes » comme celui de Démocrite et Lucrèce. Depuis que Jésus-Christ se présenta avec la revendication d’être en tant que Fils de Dieu la représentation immédiate de son Père divin et de posséder l’Esprit de Dieu, voire même de pouvoir l’octroyer : depuis, l’homme peut prétendre vouloir être lui-même l’absolu, l’autonome, qui est sa propre loi. D’après Paul, c’est cela « l’Homme du péché, l’Adversaire, qui s’élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, au point de s’asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu’il est Dieu » (2 Thessaloniciens 2,3 sq.). Mais c’est cela précisément que nous voyons apparaître dans les temps modernes sous de multiples formes, de façon pathétique tyrannique ou tout à fait banale. Comme si Jésus-Christ avait mis dans la tête, aux hommes, qu’ils étaient au fond divins et pouvaient monter dans un ciel devenu vide et occuper la place devenue libre (Ernst Bloch). Ici on oublie seulement une chose : que le Christ est apparu dans la figure de l’« abaissement », du pur service à l’égard de son Père, dans l’obéissance et dans la prière instante à celui-ci, dans la volonté de rassembler le Tout non pas pour lui-même mais pour le ramener au Père et pour « déposer tout le royaume à ses pieds ». C’est vers ces deux manières de divinisation de l’homme que courra l’histoire du monde, et également l’histoire des religions ; car même si les autres religions du monde subsistent et que les sectes se multiplient encore – elles seront prises infailliblement dans le sillage d’un de ces deux pôles. Qu’elles puissent se tenir dans une relation intérieure à [l’élément] chrétien, cela fait partie de l’auto-compréhension de cette religion « englobante » (« catholique ») : le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est le Père miséricordieux de tous ceux qui le cherchent d’un cœur loyal ; dans quelque religion qu’ils puissent vivre, le Fils de Dieu est mort dans sa Passion par Amour de Dieu et des hommes pour la faute de tous et leur a ouvert dans sa Résurrection le chemin à la vie éternelle en Dieu.
- Tel le brahmanisme, l’hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le shintoïsme. Nous pouvons passer ici les religions antiques éteintes.↩
- Chiffres de 1979, date de cet article. [Ndt]↩
- Prudence devant les formes mixtes ambiguës. On peut dire en Occident que le chemin vers l’intérieur va du moi superficiel à la profondeur du soi : la question est de savoir si ce soi est le noyau créé de la personne (alors, bien !) ou s’il est identique avec le fondement originaire divin (alors nous sommes dans le domaine oriental). On peut dire en outre, en Occident, que le noyau le plus intérieur de la personne créée est divin, et avec celui-ci il faut s’identifier. La question est de savoir si avec ce noyau on entend l’« idée » divine que Dieu avait éternellement de moi en tant qu’une personne à créer : à celle-ci je dois chercher à correspondre, la devenir n’est pas possible étant donné que l’idée est identique à Dieu que je ne peux jamais devenir en tant que créature. Finalement on peut penser, dans le christianisme, à une assimilation au Fils de Dieu naissant éternellement du Père et « en qui sont créées toutes choses » ; mais personne, qui devient « incorporé » au Fils par la grâce de Dieu, ne peut s’identifier directement à lui [le Fils] en tant que le principe qui incorpore (hérésie de l’isochristicisme). Pour chacun des trois niveaux est nécessaire – spécialement aujourd’hui – un sobre don de discernement.↩
- Origène a montré de façon particulièrement pénétrante que le fait que Dieu devienne un corps n’est compréhensible que lorsque l’on prend en considération les connexions organiques entre le corps historique de Jésus, son corps eucharistique qui construit l’Église structurée hiérarchique (le « corps mystique »), et sa présence pneumatique dans le corps de l’Écriture.↩
- Horten, Die Philosophie des Islam, Münich 1934, 38.↩
- Une religion veut-elle se démontrer comme la religion absolue, la preuve est alors nécessaire que par elle l’homme est vraiment rejoint, dans sa temporalité et historicité, et même dans son état déchu en proie à la mort et au néant ; en d’autres termes, que, aussi bien l’ordre de la création que le désordre du péché (également en tant que péché social), apparaissent être mis à l’abri en elle. Elle doit être acquiesçante au monde sans tomber dans la mondanité. En outre, l’événement historique « absolu » doit demeurer toujours actuel, pas simplement comme souvenir mais comme présence (dans le christianisme c’est là le rôle de l’Esprit Saint).↩
Hans Urs von Balthasar
Publication partielle de:
Die Antwort des Glaubens
Obtenir
Thèmes
Fiche technique
Langue :
Français
Langue d’origine :
AllemandMaison d’édition :
Saint John PublicationsTraducteur :
Antoine BirotAnnée :
2022Genre :
Extrait
Source
Revue catholique internationale Communio 32/5-6 (Paris, 2007), 15–29. Une nouvelle traduction du même texte se trouve desormais dans H.U. von Balthasar, La réponse de la foi. Freiburg, Johannes Verlag Einsiedeln, 2022, 7–40
Autres langues
Textes connexes